

Il aura fallu de la rupture pour connaitre une rentrée sans heurt et sans peur. Une rentrée qui rompt enfin avec les sempiternels atermoiements, motions, marches et grèves. A tels points que certains parents qui y ont pris leur repère, ont été surpris par la date d’hier, 3 octobre. Rentrée scolaire et universitaire.
Même si la gratuité est suspendue pour les filles du second cycle, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement de la rupture pour une rentrée académique sans polémique. Et pour ne pas être du reste, le préfet en brandissant son arrêté 0232, au nom du respect du code foncier, a tôt fait d’appeler au déguerpissement des occupants indésirables des alentours des écoles. Il est donc clair que cette rentrée rompt aussi avec les vacarmes et les désagréments absolument incompatibles avec un environnement d’apprentissage et de formation. En attendant de virer tous à l’anglais, les calendriers, scolaire et universitaire fixent dorénavant apprenants et parents, avec fort détails sur les dates qui font cette première rentrée de la rupture pour l’apprentissage des enfants, des jeunes et des moins jeunes. Et pour leur gouverne, biens des directeurs ont été forcés à déposer la craie pour avoir contribué exagérément aux faibles résultats de l’année écoulée. Le petit bémol rouge mis de côté, nous pouvons parler d’une rentrée acceptée par les syndicats, désormais contractants d’avec l’exécutif, qui attendent de voir le recrutement se faire dans la transparence et la légalité prônées et maintenues mordicus pour le nouveau départ.
Le nouvel exécutif, en recommandant aux enseignants de renouer avec la dictée, se veut porteur des ambitions de la rupture de redonner à l’école béninoise, ses lettres de noblesse.
Pour un test, la rupture aura forcé les résultats sans tricherie aucune, le nouveau départ comme sur du verglas, glisse sur l’ardeur des partenaires sociaux et tend, comme pour le délestage à nous faire oublier dare-dare, les infructueux écolages.
Et me voilà pour finir, tenté de voir en cette rentrée académique, la première rupture significative pour la nation béninoise toute entière.
Noukpo WHANNOU
03-10-2016
Dans un Bénin en proie à une jeunesse désœuvrée, à un moment où nous recherchons des pôles de croissance supplémentaires, l’activité touristique peut apporter des réponses idoines, pour peu qu’on la considère comme une action économique à part entière et non une « fabrique automatique ».
Des prémices du projets de sociétés du candidat Patrice TALON aux déclinaisons du PAG (Programme d’action du gouvernement) en passants par les balbutiements du premier budget de l’aire de la rupture, la culture nationale s’est résumée au tourisme. Puis s’est condensée en un tourisme international à travers quatre (4) puis cinq (5) grands pôles. Une vision qui pourrait se comprendre par la rigueur qu’imposent le mandat unique et une volonté affichée de donner des résultats probants sur le court terme. Un engagement à saluer qui a vu aussitôt naitre une agence nationale pour le développement du tourisme. En tandem avec le ministère de tutelle, les grands pôles sont aujourd’hui connus et les budgets alloués à leur réalisation estimés pour l’ensemble. Ainsi le tourisme béninois que dis-je la culture nationale se décline dorénavant comme une fabrique au service d’une élite étrangère hétéroclite. Une clientèle absolument pas évaluée, ni projetée. A coup sûr, le néotourisme béninois enrichit déjà plus d’un, au grand malheur du béninois lambda.
S’il est vrai que chacun des projets touristiques du PAG est bon et même très bon dans sa présentation et dans son objectif, l’approche de leur mise en œuvre gage déjà leur fiasco et ruine dare-dare l’espoir d’un essor annoncé et longtemps espéré.
Des premiers déploiements de l’ANDT (Agence Nationale pour le Développement du Tourisme) nous n’avons eu vent d’aucun état des lieux, ni d’étude de faisabilité qui tienne compte des réalités du terrain, des potentialités des acteurs qui déjà s’investissent dans cette filière, ni d’une vision à moyen et long terme clairement définie. Le tourisme béninois depuis quelques mois, est mis en branle comme si rien dans ce secteur n’a jamais été fait ; et l’on a l’impression que même les matières d’œuvres n’ont jamais existé et devront être créé pour ce faire. En définitive, on ne gardera, avec cette lancée, de notre culture, de notre patrimoine, de nos différents sites et autres richesses que le nom.
Comment n’a-t-on pas pu trouver au Bénin, deux maîtres d’œuvres agrégés et quelques techniciens supérieurs en équipement et en génie civile pour assister à la maitrise d’ouvrage de la future cité lacustre de Ganvié. J’ose espérer qu’un collège de béninois avertis ou quelques jeunes diplômés absolument désœuvrés seront associés à ce projet afin d’acquérir un peu de cette expertise mondialement connu pour ce qui est de la montage, c’est certain, mais pas du tout en ingénierie écologique appliquée aux milieux aquatiques. Nous voilà encore dans le vicieux cercle de la colonisation qui s’étale tout feu pétillant sur notre culture.
Deux préoccupations majeures, du premier coup ne sautent pas à l’œil dans cette lancée du néo tourisme béninois :
Une relance de l’industrie touristique en marge totale de l’existant et
La déshumanisation d’un secteur qui se formalise en une fabrique de produits, avatars exotiques sans ancrage aucun avec nos traditions ; et ceci même sur les pôles qui apparemment sont censés intégrer l’offre au plus près des populations.
En effet, quoiqu’étroit et limité, le tourisme béninois existe depuis qu’existe le Bénin. Et c’est à juste titre que cette année, il a généré sept milliards de franc CFA. Sept milliards générés à la sueur de ces acteurs traditionnels qui s’efforcent pour tenir une filière dans laquelle avec tous les espoirs, et sans accompagnement, je dis aucun, ils s’investissent quotidiennement. Comment un programme de société s’il est humain puisse se passer de tout cet existant pour nous initier un nouveau tourisme, déclaré aussitôt déjà, vecteur de croissance et d’emploi, portant la vive ambition de faire de notre pays une destination touristique de référence. Comme si, ceux qui, depuis des décennies œuvrent dans le secteur, sont sans ambition et n’y ont jamais créés d’emploi. Même si, il leur est nié de facto une expertise, l’on ne saurait occulter la longue expérience dont ils jouissent.
Je vois sous cette fondation du tourisme de la rupture, les élans du projet Manioc pour la reconversion des Zémidjans sous Kérékou et ceux de la promotion de l’agriculture sous YAYI ; où les vrais acteurs sont laissés en marge de reformes dont nous avons tous vus la portée. Je me tais sur les milliards du FNPEJ distribué avec le même zèle que nous peinons à recouvrir depuis. Nous gagnerons sûrement à relever le tourisme béninois de ses sentiers battus, lui apportant l’appui nécessaire, plutôt qu’à en créer un autre, pour nous forcer à tourner en rond.
Porto-Novo, Ganvié, Ouidah, Allada, Abomey et Nikki. Voici les villes qui rêvent de porter les grands pôles du Bénin Touristique Révélé. Peut-être devrons-nous oublier Boukoumbé depuis que ses arbres séculaires ont été froidement abattus et ont entrainé la déchéance de l’Ange de la Culture, parti nous l’espérons bien avec toutes ses bonifications. Grands pôles qui n’ont rien d’humain si l’on y prend garde et qui risquent de nous acculturer d’avantage ; certains qu’ils nous vendent déjà pour ce que nous ne sommes pas. Voici la fabrique dont je parle. Ce tourisme conçu dans des laboratoires trop lointains, préfabriqué à l’étranger puis installé dans nos villes historiques pour récolter les billets de banques de touristes bêtement conduits à l’abattoir d’un exotisme imaginé pour la circonstance, dans le seul but de faire tourner la planche à billets, multiplier les devises à leur propre compte et non pour l'économie locale et nationale. Avec le sulfureux espoir d’une communication acérée, capable de faire avaler à nos visiteurs les pythons du temple de Ouidah.
Non, le tourisme est une action économique à part entière ; et le tourisme Béninois, s’il doit être promu, révélé, se doit d’être traité au même titre que le coton, le port autonome de Cotonou ou les fonctionnaires du ministère des finances. C’est peu demandé pour les acteurs de cette filière, eux aussi béninois à part entière, et surtout pour nos enfants, incontestables victimes de cette fabrique automatique. Tant il leur sera vendu une histoire qui n’est pas la leur, des héros difformes, loin de la vérité que portent leurs gènes et leur sang. Un tourisme pour nous acculturer au lieu de nous ressourcer. A moins de garder l’intime certitude de devoir jamais consommer ce que nous même produisons.
04-11-2017
Noukpo WHANNOU
Il est de bon droit de concrétiser nos rêves d’un Bénin lumineux pour le futur. Je garde le ferme espoir de voir au soir du 1er janvier 2021, nombres des réalisations promises par le Président de la République prendre corps. Je n’en doute point et je me réjouis d’y participer activement. Mais il est une raison que je ne saurais avoir, c’est celle d’effacer mon passé.
Non je dis. Il n’est nul besoin pour construire un Zénith de raser un joyau national, une belle part de notre passé récent, de notre culture, le palais des sports. Déjà que nous manquons d’infrastructures du genre, de quel droit voudrions nous rasez le Palais des sports. C’est un temple rempli d’histoire et un monument à préserver pour les générations futures. Quelle histoire du Bénin voulons nous raconter dans dix, trente ans si nous détruisons allégrement nos patrimoines. Il est encore dans Cotonou et environs, biens de domaines de l’Etat où ce nouveau temple de 7000 places peut allègrement resplendir de ses mille feux futuristes.
Non, nul n’est besoin pour construire un Zénith de raser le Palais ; car au faîte de sa gloire, le PINACLE ne nous est pas parvenu pour avoir traversé le temps, mais parce qu’il a été préservé. Préservons notre Palais.
Noukpo WHANNOU
14-03-2017
Béninoise, habitante du monde, il faut sortir pour voir, du moins entendre, prêter ton oreille attentive à la danse des mots, quand le verbe se fait herbe pour enivrer, porter l’esprit par-dessus le corps et essayer de le délier du trivial qui tente de contraindre nos habitudes. Il faut sortir pour entendre lire Les Didascalies du Monde que pour nous, SUDCREA voit que c’est bon. Sortez béninoises, pour vous nourrir du verbe De Jérôme-Michel TOSSAVI qui libère du train-train quotidien. C’est aller résolument à l’église originelle, tâter le divin comme au commencement.
Noukpo WHANNOU
L’auteur du premier texte de cette seconde aventure des Didascalies du Monde, le porteur du verbe, c’est Jérôme-Michel TOSSAVI. Droit dans ses bottes qui n’en prend qu’un pour dire en tant de mots : laissez-nous notre mare. Coasser, encore et encore de mille manières avec autant de tournures, c’est le verbe qu’il aura choisi pour ériger la démocratie chez les grenouilles.
L’auditorium de l’INSTITUT Français de Cotonou qui a généreusement accueillie cette première lecture conduite par onze passionnés et qui inaugure la saison 2019 de cette belle périple lyrique, a plongé une cinquantaine d’auditeurs dans l’ambiance métaphorique de cette parodie tirée de la pièce ‘’Démocratie chez les grenouilles ‘’. Une musique faite à dessein nous rappelle de temps en tant que ce qui devant nous semble naturel, tient moins de l’improvisation. Des mouvements s’invitent pour accompagner, le verbe coasser et d’avantage nous priver de notre liberté de penser. C’est la touche directrice de Giovanni HOUANSOU qui vient, coercitive, nous rappeler qu’à l’évidence nul n’est forcé. Nous y avons cru. Tant les répliques, les relances, et l’harmonie de nos lecteurs éludent constamment la mauvaise gestion du souffle et l’épellation qu’exige l’audition quand on l’espère parfaite.
C’est claire Jérôme-Michel TOSSAVI S’adresse aux autorités, autorités d’ici et d’ailleurs, du monde des humaines, celles dites compétentes, apporteuses de lumière qui vainement s’imposent au monde, prêtes à faire table rase du présent, peut-être même du futur. On finit, à les entendre défendre leur position, leur imposition, par se demander si elles existent encore ; tant elles se sont muées en des avatars qui croient fermes qu’elles sont la lumière qu’elles étaient sensées porter. Et la grenouille père s’est faite petite et se refuse de croire qu’elle doit se séparer de sa mare, dont elle et ses paires ont de temps en temps marre. D’arme, les grenouilles n’ont eu que leur verbe, un seul pourtant : COASSER. Elles n’ont eu qu’à coasser pour embêter, détourner, contraindre, convaincre et finir par se faire entendre.
D’une manière ou d’une autre elles en auront appris beaucoup de la lumière et de la façon dont il ne faut pas la porter. Et si la mare demeure, rien n’est sûr après elles encore moins pour elle, la mare.
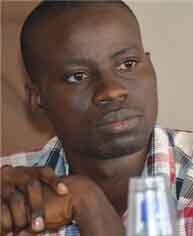
J’aurais aimé titrer : « De la curie boueuse contre l’incurie des maux. » Mais l’on aura tôt fait de penser à la traite négrière qu’on n’a pas soldée, à la colonisation qui perdure, à la guerre de Biafra, aux invectives des mille collines ou à des élans pervers si récent, plus près de nous.
Jérôme-Michel TOSSAVI parle au-delà de maintenant, il arrache sa langue au fable pour nous demeurer plus longtemps. Et ça, c’est bien qui serait mieux si les autorités d’ailleurs et surtout d’ici, allaient s’abreuver du verbe coasser.
Ceci n’est que la première évidence qu’avec peu de mots et un seul verbe, le principe éclaircit, illumine et libère. Non plus la parole déjà acquise, conquise par la parodie, genre qui s’impose par excellence en temps troubles ou quand la liberté de s’exprimer, pour s’affubler de son droit d’ainesse, se dévêt de toute forme de condescendance. Mais libère le verbe ; lui qui est commencement. Il est plus question ici de justice que de coutume, celle qui veut qu’on laisse notre mare. De l’auteur, nous parlerons; au texte, nous y reviendrons.
Jérôme-Michel TOSSAVI est un jeune écrivain Béninois. Détenteur d’une maîtrise en sciences humaines, option Lettres Modernes. Poète convaincu, Jérôme oriente aussi ses écrits à l’endroit du jeune public et il ne doit rester encore dans les rayons que quelques exemplaires de son premier roman ‘’Oraisons pour un vivant’’ sorti cette année ; un succès de librairie.
La mise en lecture a été dirigée par Sèdjro Giovanni Houansou, avec la participation de Lopez Faizoun, Carlos Zinsou, Sybelline de Souza, Victor Goudahouandji, Ariax Dakpogan, Barbara Ganyé, Carlaine Semadégbé, Nawarath Boni, Paul Otchadé, Ernest Kaho, Carole Lokossou et Richmond Dakpogan. Nous disons merci à ce beau monde pour plus de démocratie chez les grenouilles.
Noukpo WHANNOU
18 juillet 2019

Dans l’Afrique du Sud des années soixante, trois belles dames tombent amoureux d’un seul et même homme condamné à mort. Et Jean Pierre Békolo trouva de quoi défendre la vie et le droit d’être, tout court.
Christian Noukpo WHANNOU |
Andréa Larsdotter, qui depuis 2009 tient l’affiche dans des films célèbres tels que Bjudlocket, Hälsoresan et 7333 Sekunder, revient dans Miraculous weapons pour accompagner Xolile Tshabalala et Maryne Bertieaux dans des larmes fortes qui poussent l’immortel Djamal Okoroko (Emile Abossolo M’bo) vers une fin certaine. Un film écrit et réalisé par Jean Pierre Békolo.
Depuis Quartier Mozart et les saignantes, Jean Pierre Békolo a porté une vision coercitive de ses engagements et se plait à y aller, pas à pas. Miraculous weapons vient confirmer qu’il tient à aborder divers sujets et se donne le droit de les traiter en profondeur. Que diable avons-nous fait d’un condamné à mort qui ne s’en sortira point ; un polygame heureux ? Que n’a-t-on pas fait de subir les efforts d’une femme belle pour se maintenir en vie et porter pour deux, l’espoir d’un demain nouveau. Et il aura fallu Jean Pierre Békolo pour lui en rajouter deux, des plus sublimes de par leur forte tête et leur élan humaniste. Et quand le héros principal finit par nous dire face à une mort assurée, après une foucade de rire sarcastique qui dénote et aggrave la fatalité de l’instant, qu’il est immortel, toute la mesure de l’appel à la vie s’imprime dans l’échos même de ces pas qui conduisent au supplice.
La langue française rappelle la poésie et offre un Jean Paul Sartre comme l’alibi pour s’accrocher à l’espoir d’un appel en cassation qui sera rejeté. Les années soixante sont bien présentées avec les stéréotypes de soldats blancs et la beauté des scènes extérieures qui vous rappellent l’Afrique d’antan. Belle musique qui rythme l’évidence et chante l’inéluctable. Des plans taillés sur mesure, des compositions symétriques qui rendent des décors confinés et explorent l’espace par une triple présence de femmes ; trois futures veuves qui se cherchent dans une cuisine où leur présence trouble l’obsolescence même du rôle premier de l’épouse. Elle se donnent le courage de ne désespérer quand tout les unit ; pour devant le pire, ne penser qu’au meilleur.
Jean Pierre invite à la vie, avec des larmes. Et si la plus faible des armes qui force bien souvent des destins, dans ce cas-ci s’avère impuissante, celles de Jean Pierre, chantent tout au moins, un hymne à la vie.
FESPACO, Ouagadougou,
Février 2019

C’était évident que pour une première africaine, le pays des hommes intègres qui a franchement affiché sa position face à la récurrence du sujet de l’homosexualité, n’adouberait de manière ostentatoire une promotion du lesbianisme dans la programmation du prestigieux FESPACO.
Christian Noukpo WHANNOU |
Le film de Wanuri Kahui mérite bien la promotion que lui fait le FESPACO en la maintenant d’office dans la compétition officielle. La simplicité de l’approche a ceci d’émouvant qu’elle rapproche deux êtres de chair qui ne désirent qu’à vivre, exister et s’exprimer. Rafiki, durant 82 minutes présente l’homosexualité telle qu’elle semble apparaître en Afrique et ne fait, en fait que ça. Des images douces, une mise en scène épurée et des comédiens qui se refusent à aller plus en avant, convaincus qu’ils ont le devoir de réserve face à l’Afrique et à sa culture. Avec un scénario bien élaborée pour ce seul et unique but : prendre le risque de présenter l’homosexualité et ne faire que la présenter, Wanuri Kahui avait toute la largesse de faire vivre son art et s’en ai donné à plein joie. La présence du son qui enrobe des séquences bien pensées et légèrement hésitantes viennent confirmer la volonté de la réalisatrice à planter le décor et poser le débat ; et s’arrêter à cela.
Dans une ambiance décontractée, des personnages sans forte personnalité avancent en nous contant leur quotidien que rien ne semble perturber. Parmi eux, trois sont quasi fortes dans leur rôle. Pleines d’expression et de soudaineté, les trois drôles de dames qui nous tiennent l’affiche sont belles. La mère de Kéna intransigeante pose ses jalons et se refuse d’assumer ses responsabilités. Elle ne suffira pas à justifier les causes des désirs selon certains ou des déviances qui poussent sa fille dans les bras d’une autre. Il y a aussi Ziki et Kena qui nous ont prouvé qu’elles peuvent jouer et extérioriser l’âme de cette Afrique de demain. Et c’est déjà bien qu’elle s’affirme à travers leur art pour une Afrique nouvelle quelle semble dire, n’est pas prête pour des lesbiennes de leur acabit. Qu’à cela ne tienne, nous avons eu du plaisir de découvrir une photo épurée et des scènes spontanées qui manquent d’innovation et de de composition. Naïveté d’une part et violence de l’autre ; à travers des séquences nécessairement pas très bien négociée. Mais on se réjouit du rythme des actions et de la fin qui porte la problématique dans son essence telle que la vit pour l’instant les peuples d’Afrique : celui d’un imaginaire qui nous garde loin de ces pratiques que nous savons, existent bien quelque part. Meilleure réalisation et meilleure image déjà pour son film From a Whisper, nous disons bravo à la jeune Kényane de 39 ans qui depuis 2009 s’impose à travers sa vision d’une Afrique nouvelle.
FESPACO, Ouagadougou,

Un tohossou, dans la culture de chez nous, est une personne malformée de naissance que les ainés et les sages jugent inappropriée de vivre en société. Le reste n’est pas le sujet de l’instant. Mais il nous en pleut, par ces temps-ci, un peu trop sur nos pavées fraichement asphaltées. Des tohoussous qui se croient plus vivants que tous, sautillant allégrement sur leur seule jambe, ou exhibant leur face horrifiante, cravate à la hanche, mocassin en boucle d’oreille ou laissant trainer leurs intestins débordant de leur ventre ouvert à moitié. Non, les monstres ont leur autel pour être adorés, leur couvent pour appeler au recueillement et leur forêt sacrée pour sauver l’apparence. En société, il nous faut des hommes, simples, bêtes parfois, fous aussi ; mais de bons vivants qui rappellent à tous qu’ils sont béninois et vivent en symbiose avec les choses et les êtres d’ici ; et pas uniquement d’ailleurs. Que la rupture cesse de nous fabriquer des monstres, hommes parfaits qui n’ont de béninois que le nom mal prononcé avec aise et dédain parfois. Voilà de l’introduction un peu trop courte pour aborder le leasing contre lequel je n’ai absolument rien dans son principe et dans son efficacité.
Le leasing peut se faire sur les ouvrages de nos artisans pour meubler bureaux et salles officielles, dans nos communes, dans nos départements. Un maire, un préfet ne peut administrer efficacement Lalo, Kérou ou Porto-Novo en vivant quotidiennement entre l’Europe et la Chine.
Le leasing peut aussi se faire sur les tableaux de nos artistes qu’ils soient plasticiens, sculpteurs, architectes ou décorateurs d’intérieur. Nos cadres dits compétents seraient moins des tohossous à notre service ; un cadre sans culture n’en est pas un, vraiment.
Pour l’amour de Dieu, le leasing peut se faire sur les takos, les bohounbas, les kanvohs, pour voir moins de faux colons qui se nient à nos cérémonies officielles. Une autorité qui ne ressemble pas à ses administrés n’en est pas une, absolument.
Le leasing doit se faire sur les programmes de nos chaines de radio et de télévision, il ne faut pour ça qu’une simple décision de la rupture. Une béninoise qui consomme la culture étrangère à longueur de journée n’en est pas une, aucunement ; c’est une tohossou qui en enfante une multitude qu’elle éduquera pareillement.
Le vrai leasing est celui qui ‘’ amène à économiser tous les francs de l’Etat’’ et non un seul.
Je me permets de faire rupture avec ce vieux terme de ‘’local’’ qu’il faille consommer comme les vaccins de l’UNICEF. Nos productions ne sont plus ‘’locales’’ depuis qu’elle sont vendues au même titre que d’autres dans les plus grands magasins au monde, sur les plus grands marchés et pour d’autres comme le coton, l’anacarde ou l’ananas, cotées à la bourse. Nous sommes bons, très bons parfois même. Il ne nous manque que les fonds.
Malheur à tout béninois qui encensera un leasing qui appauvrit le contribuable béninois et enrichit les firmes étrangères. Trois fois malheur à l’apatride qui finira tohoussou et en enfantera : C’est là ma prière ce matin à tous les vrais tohossous du Bénin à qui la rupture insidieusement usurpe l’existence.
Noukpo WHANNOU
22 octobre 2022

Le court métrage de Jaurès KOUKPEMEDJI m’offre, à visage découvert, l’une des facettes peu révélées de mon pays. Celles des hommes impuissants face à leur femme. Pour peu qu’elle se sente suffisante et autoritaire. Non pas qu’elle soit instruite du bout des ongles manucurés, qu’elle travaille dans l’administration, qu’elle soit quasiment seule à régenter la famille ou qu’elle veuille coûte que coûte assurer l’avenir de leur enfant ; mais trop souvent parce qu’elle se sent mieux si tout va comme elle le désire, pour son bon apparat et les meilleurs « qu’en dira-t-on ? ».
Le court métrage de Jaurès KOUKPEMEDJI m’offre, à visage découvert, l’une des facettes peu révélées de mon pays. Celles des hommes impuissants face à leur femme. Pour peu qu’elle se sente suffisante et autoritaire. Non pas qu’elle soit instruite du bout des ongles manucurés, qu’elle travaille dans l’administration, qu’elle soit quasiment seule à régenter la famille ou qu’elle veuille coûte que coûte assurer l’avenir de leur enfant ; mais trop souvent parce qu’elle se sent mieux si tout va comme elle le désire, pour son bon apparat et les meilleurs « qu’en dira-t-on ? ».
C’est cet incompris que je cherche encore à comprendre en me remémorant chaque séquence que Jaurès KOUKPEMEDJI et ses colistiers de l’ISMA (Institut Supérieur des Métiers de L’audiovisuel) ont efficacement négocié en restant collés aux instructions académiques. Des plans rigoureux, un éclairage tout sauf sophistiqué qui rend fidèlement compte de l’harmonie générale voulue à l’œuvre. De bons choix de musiques pour imprimer le rythme et un son bidouillé avec dextérité aurait été meilleur sur un matériel plus approprié. En présentant des dialogues fort simples mais qui reflètent le naturel, le jeune réalisateur, avec son équipe, a gagné le pari de restituer le quotidien. Un trivial qui une fois encore, manque de coller à l’inaction morbide du père de Bryan (l’acteur principal du film) qui, somme toute, rend compte d’une psychologie qu’il faille approfondir à travers d’autres thématiques. Pourquoi garder des bras encore forts le long du corps et regarder son enfant s’en aller à la perdition ? Que l’on se refuse de porter la culotte, passe encore ; mais que l’on manque de porter secours, autoritaire ou subtile, en cachette ou à visage découvert, est incompréhensible. Je le répète, la jeunesse a le droit de se tromper. Et ici déjà, on peut sans trop se tromper, pointer du bout des doigts le père de Bryan, d’être l’incompris du drame qui se trame sous son regard que je me refuse de qualifier d’incompris.
Jaurès KOUKPEMEDJI et ses amis ont réussi à s’imposer les normes, et ont fini par oublier de s’amuser, de laisser libre court à leur imagination. C’est clair, un réalisateur nous est né ; qu’on le voit, est bon. Maintenant, qu’il veuille bien se distraire et nous divertir. Bravo à l’artiste.
Christian WHANNOU,
Ouagadougou,
Fespaco 2019